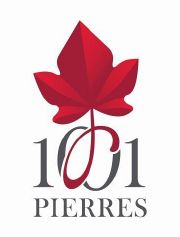Exploitation viticole de Philippe Leymat
Exploitation viticole en agriculture biologique
Philippe Leymat
Philippe Leymat, viticulteur en Corrèze, a fait le choix d’une viticulture en agriculture biologique et agroécologique pour préserver la santé des sols et limiter l’usage des intrants chimiques. Conscient des défis liés aux aléas climatiques, il cherche des solutions pour améliorer la résilience de son exploitation face aux épisodes de gel et optimiser la gestion des sols et de la biodiversité.
Contexte
Contexte régional
- Climat : océanique avec 1140 mm de pluie bien répartie sur l'année
- Région vallonnée historiquement tournée vers l’élevage bovin (race limousine), la culture du tabac et des noix.
- Relance du vignoble en 1986 après la crise du phylloxéra, avec une conversion progressive en bio dès 2000.
- Forte attractivité touristique (proximité de Collonges-la-Rouge, Rocamadour, Sarlat) influençant la commercialisation du vin.
Contexte de la ferme
- Nom de la ferme : Exploitation individuelle depuis 2016.
- Localisation : Branceilles, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine.
- SAU : 10 ha de vignes (8 ha en propriété, 2 ha en location).
- UTH : 1,5 (Philippe + 1 salariée en CDI partiel + aide saisonnière).
- Cultures : Viticulture en agriculture biologique (Cabernet Franc, Gamay, Merlot, Chardonnay, Vermentino).
- Sol : Argilo-calcaires caillouteux anciennement truffiers, d’où le nom de la coopérative “1001 pierres” dont Philippe fait partie.
- Cahier des charges : Agriculture Biologique.

Enjeux locaux
L'exploitation est localisée dans une région très touristique (proche de Collonges-la-Rouge, Rocamadour, Sarlat), ce qui influence fortement la commercialisation des produits. Le vignoble de Branceilles joue un rôle central dans l'identité locale. La problématique principale de la zone est celle du gel, avec une augmentation des aléas climatiques au cours des dernières années.
Motivations et objectifs
Philippe est engagé dans des dynamiques collectives et syndicales. Il souhaite favoriser l'autonomie et l'entraide au sein des exploitations agricoles.
Il s’engage dans une viticulture biologique pour plusieurs raisons :
- Préservation de la santé : Il a été témoin des impacts négatifs des pesticides sur les générations précédentes d’agriculteurs et refuse d’exercer en conventionnel.
- Qualité des sols et biodiversité : Il cherche à améliorer la structure et la fertilité des sols en utilisant des couverts végétaux et en limitant les intrants.
- Résilience face au climat : Les gels récurrents depuis 2017 impactent fortement la production, d’où sa recherche de solution pour limiter ses effets, sans succès pour le moment.
- Accessibilité du bio : Il milite pour un modèle biologique économiquement viable pour tous, en évitant qu’il ne devienne un luxe réservé à une élite.
Étapes de transition
- 1999 : Installation sur l’exploitation familiale en polyculture-élevage (élevage bovin, tabac, noix, vigne).
- 2008 : Arrêt de la culture du tabac et tentative d’élevage de poules pondeuses en agriculture biologique dans l’ancien séchoir à tabac (abandonné pour cause de poux rouges).
- 2011 : Entrée en GAEC des Gariottes avec ses beaux-frères et un ami, référent viticulture et aviculture. Introduction de semis de méteil conçu pour l'alimentation animale dans les vignes.
- 2011-2014 : Conversion progressive de la viticulture en agriculture biologique.
- 2015-2016 :
- Entrée au bureau d’InterBio Nouvelle-Aquitaine.
- Prise de la présidence de la coopérative Vignoble de Branceilles 1001 pierres.
- Départ du GAEC des Gariottes et passage en exploitation individuelle avec une spécialisation en viticulture (extension de 4 à 10 ha de vignes).
- Poursuite de la transition vers l’agriculture biologique et agroécologique.
- 2017 :
- Certification AOC Vins de Corrèze.
- Premier épisode de gel impactant fortement la production.
- Lauréat du projet “Haies Sens Ciel” en Nouvelle-Aquitaine.
- 2019 : Deuxième épisode de gel.
- 2020 : Expérimentation d’un engrais foliaire en partenariat avec l’entreprise Vitivista.
- 2021 : Troisième épisode de gel, aggravant les pertes de rendement.
- 2022 : Prise de la présidence d’InterBio Nouvelle-Aquitaine.
- 2023 : Quatrième épisode de gel et forte attaque de mildiou, mettant en évidence les défis persistants de la transition agroécologique.
Descriptif du système actuel
Superficie et implantation des vignes
- L’exploitation viticole s’étend sur 10 hectares de vignes, dont 8 en propriété et 2 en location.
- Les vignes sont implantées sur des porte-greffes Fercal, 41B et SO4, mais évoluent progressivement vers des porte-greffes plus adaptés aux conditions locales, comme Gravesac et R110.
- L’implantation suit un palissage à 1,6 m de hauteur sur des rangs espacés de 2,5 mètres, avec un écart de 1 mètre entre les pieds.
Cépages cultivés
- L’exploitation cultive une diversité de cépages, comprenant des cépages rouges tels que le Cabernet Franc, le Gamay et le Merlot, ainsi que des cépages blancs comme le Chardonnay et le Vermentino, un cépage d’origine Corse.

Gestion des sols
- La gestion des sols repose sur l'utilisation de couverts végétaux, avec une moitié des rangs semée en couverts intégrant des légumineuses.
- Cette année, un semis de féveroles pures a été effectué pour améliorer l’apport en azote, après une préparation du sol en août et un semis en septembre.

Focus sur le couvert de féverole 1 rang/2 dans les parcelles viticoles de Philippe Leymat à Branceilles - L’itinéraire technique comprend un travail du sol 1 rang sur 2 avec l’intercep à lame pour couper et déraciner les adventices ainsi que le démotteur pour casser les mottes et affiner la structure du sol. Les couverts sont détruits par broyage. Un palissage soigneusement géré permet de maximiser la vigueur de la vigne et la qualité des raisins.
Fertilisation
- La fertilisation est assurée par l’utilisation d’engrais foliaires et les couverts végétaux.
- L'apport de fumier, devenu de plus en plus rare dans la région, a été abandonné en 2015. Les amendements sont désormais fournis par la coopérative d’approvisionnement locale.
Protection des cultures
- En matière de protection antifongique, l’exploitation utilise principalement du cuivre et du soufre.
- Le suivi phytosanitaire est assuré par un conseiller de VitiVista, une entreprise spécialisée dans le conseil et la distribution d’agrofourniture.
- Philippe ne considère pas qu’il soit nécessaire de faire un traitement insecticide étant donné qu’il y a très peu de ravageurs à part quelques attaques de cicadelles.
Irrigation
- Pas d’irrigation.
Résultats constatés
- Les résultats observés montrent une amélioration de la structure du sol et de la vie du sol, avec une présence accrue de vers de terre.
- Cependant, la forte variabilité climatique, notamment les épisodes de gel et les attaques de mildiou, a un impact considérable sur les rendements, pouvant affecter plus de 80% des potentialités de production.
- Philippe a déjà essayé de brûler du foin à proximité des rangs de vigne mais sans succès. Son projet serait d’avoir une tour antigel mais sa trésorerie ne lui permet pas d’en acquérir une. Ainsi, il n’a aucun moyen de lutter contre le gel.
Autonomie
Un de ses objectifs est de limiter l'apport d'intrants azotés en privilégiant les couverts de féverole.
Équipement
- Le parc matériel est géré en CUMA et comprend divers équipements essentiels pour les travaux viticoles, tels que des tracteurs, pulvérisateurs, broyeurs, outils de travail du sol et une machine à vendanger.
- Pour le travail du sol, l'exploitation dispose d'interceps, de disques émotteurs et de lames, permettant un entretien efficace des parcelles.
- Toutefois, certaines innovations nécessitent des équipements spécifiques qui manquent actuellement, comme les écarteurs de fils releveurs. L'acquisition d'une tour à vent collective équipée d'un système de chauffage pour lutter contre le gel reste économiquement irréalisable, car elle impliquerait en plus le paiement d'une assurance spécifique contre le gel.
Investissements
Philippe loue 2 ha de vignoble afin de compléter ses 8 ha dont il est propriétaire.
Commercialisation
La grande majorité de la commercialisation se fait en bouteille, directement à la cave coopérative. Des marchés locaux et quelques salons permettent également d’écouler une partie de la production.

Stockage
Philippe ne stocke rien sur son exploitation et donne toute sa production à la coopérative.
Bilan économique, social, environnemental
Bilan économique
- Philippe atteste de bonnes ventes en vin bio, avec une demande supérieure à la production dans son secteur.
- Néanmoins, depuis son arrivée à la coopérative, plusieurs épisodes de gel ont provoqué des pertes de revenus (2017, 2019, 2021, 2023). Il est ainsi essentiel pour lui de sécuriser les rendements pendant les “bonnes années” pour pouvoir faire face aux “mauvaises” années pendant lesquelles il n’a presque pas de revenus.
- Il a perçu un peu d’aides de la PAC et d’investissement CUMA. Sa production ne lui permet pas d’attendre 1000-1200€ / mois, mais ses revenus complémentaires en tant que directeur de la cave à mi-temps, adjoint à la commune et les défraiements d’Interbio lui permettent de vivre convenablement.
Bilan social
- Le temps de travail annuel est estimé à 200 h/ha, avec 4 000 pieds par hectare, répartis à 80 % entre le 1er janvier et le 20 juillet.
- L'exploitation emploie une salariée en CDI à temps partiel annualisé et son conjoint en saisonnier de janvier à juin, principalement pour les tâches manuelles (taille, épamprage, relevage). Philippe gère toute la partie mécanique.
- Bien qu'il trouve parfois les charges de travail accablantes, il gère relativement bien la pression, notamment en optimisant l'engagement de main-d'œuvre pour respecter les délais de travail. Il prend soin de s’accorder des pauses de 48 heures par semaine.
- À part les aléas climatiques, il considère avoir une vie professionnelle épanouie. La principale difficulté reste la sécurisation de la production.
Bilan environnemental
Philippe observe une amélioration de la santé du sol par évaluation visuelle.
Avantages / limites des pratiques mises en place
Avantages
Le système de production du viticulteur présente plusieurs avantages :
- Une meilleure résilience écologique.
- Une amélioration continue des sols.
- Une proscription des intrants chimiques, ce qui favorise la durabilité et la santé du vignoble.
Limites
- Les traitements doivent être répétés régulièrement, ce qui peut engendrer des coûts supplémentaires et une charge de travail accrue.
- L’exploitation ne dispose pas de système anti-gel, exposant ainsi les cultures aux risques climatiques. Ces risques ne sont pas toujours compensés par les aides, ce qui crée des incertitudes économiques.
- Certaines pratiques en bio sont soumises à des contraintes réglementaires strictes, limitant la flexibilité du viticulteur dans ses choix agronomiques.
Perspectives
- L’exploitation pourrait être économiquement performante sans les aléas climatiques qui impactent sa production. Pour améliorer sa résilience, plusieurs actions sont envisagées, notamment la complantation et une rénovation des 2 hectares de vignes en location afin d’améliorer leur rendement, les vignes étant en très mauvais état au moment de la location. La sécurisation des volumes de production face aux risques de gel est également une priorité.
- Sur le plan agronomique, des alternatives à l’utilisation du cuivre, devenu moins efficace, doivent être explorées, tout comme la mise en place d’un enherbement total des parcelles.
- Pour faire face aux défis climatiques, de nouvelles solutions contre le gel, comme l’aspersion et l’utilisation d’une bouillie de type blanc arboricole pour retarder le débourrement (BNA Lhoist), sont à l’étude.
- Engagé dans la préservation de la biodiversité, l’exploitant a été lauréat de l’Agence Bio Nouvelle-Aquitaine pour son projet "Haie sens ciel", qui vise à favoriser les corridors écologiques et la faune auxiliaire au sein du vignoble. Par manque d’investissement ce projet n’a pas encore pu voir le jour.
- Il souhaiterait également diversifier ses sources de revenus. Un autre projet est alors à l’étude : l’implantation de haies à vocation truffière au sein de ses parcelles viticoles. Ces haies agroforestières pourraient donc également constituer des corridors de biodiversité.
Conseils de l'agriculteur
- Une bonne anticipation des coûts et des besoins en trésorerie est primordiale afin d’assurer une gestion financière sereine dès le départ.
- L’expérimentation et l’adaptation aux contraintes locales doivent être au cœur de la démarche pour développer des solutions adaptées et durables.
- Il est crucial de valoriser le travail collectif et le partage de connaissances, car ces échanges constituent des leviers essentiels pour progresser et pérenniser son activité viticole.
Si c'était à refaire ?
Si Philippe devait recommencer son exercice, il referait la transition vers le bio, mais avec une gestion plus réfléchie des risques climatiques et économiques. Il remettrait à l'œuvre la grande majorité de ses choix, en mettant l’accent sur une meilleure anticipation et une planification plus rigoureuse de la transition. Il chercherait également davantage de financements pour sécuriser la production et limiter les aléas. Fort de son expérience, il ne conduirait jamais son exploitation en conventionnel, convaincu par les retours négatifs des générations d’agriculteurs précédentes, qui ont souffert de conséquences graves, comme des décès précoces, dues aux pratiques conventionnelles.
Source
La version initiale de cet article a été rédigée par Lise Antunès, Pauline Castel et Alioscha Lambert.
étudiants en agronomie à l'Institut Agro Montpellier, suite à l'interview de Philippe Leymat, réalisée le 11/02/2025.
Cette page a été rédigée en partenariat avec Institut Agro Montpellier, avec la coordination du Centre National d'Agroécologie